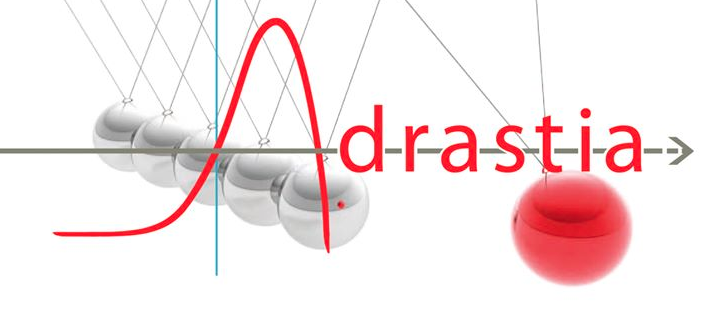Réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de la consommation énergétique finale, réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique... Votée ce mardi 26 mai par l’Assemblée nationale, la loi relative à la « transition énergétique pour la croissance verte » consacre, selon la volonté des députés, « un ensemble d’objectifs sans hiérarchie particulière entre eux ». Et avec certaines contradictions.
Après son étude depuis plusieurs mois entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, le projet de loi relatif à la « transition énergétique pour la croissance verte » donne finalement à la politique énergétique nationale, après les travaux d’une commission spéciale de députés, les objectifs de réduction suivants :
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et division par quatre des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.
- Réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012.
- Réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, avec un objectif intermédiaire de 20 % en 2030.
- Réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025, contre 75 % actuellement.
Comment concilier la diminution de la part du nucléaire de 75 à 50 % de la production électrique d'ici 2025 tout en maintenant la capacité de production de cette énergie et tout en réduisant la consommation énergétique finale de 20 % en 2030 ?
Toujours selon la loi, ces réductions s’entendent en portant la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030, en menant une politique volontaire de rénovation thermique des bâtiments, en développant fortement les véhicules électriques, ou encore en limitant la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire à 63,2 gigawatts, c’est-à-dire en conservant en fait la capacité nucléaire actuelle.
Résumons: réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030, réduction de la consommation énergétique finale de 20 % en 2030 et réduction de la part du nucléaire dans la production électrique de 75 à 50 % d’ici 2025... Cela correspond à la demande initiale du Président François Hollande, mais ceci rester insuffisant pour démontrer la cohérence de l’ensemble.
1ères contradictions, comme le notent des milieux écologistes: comment concilier une telle réduction de la part du nucléaire dans l’électricité française tout en maintenant la capacité actuelle de cette énergie? Réponse : en augmentant fortement la consommation électrique, de l’ordre de 50 % d’ici 2025, ce qui n’est pas en harmonie, euphémisme, avec l’objectif de réduction de la consommation énergétique de 20 % en 2030...
D’un autre côté, comment réduire la part du nucléaire dans l’électricité tout en baissant la consommation énergétique ? En baissant drastiquement sa capacité de production, ce qui là encore n’est pas cohérent avec le maintien de sa capacité actuelle... On pourrait également se demander si le choix de ramener la part du nucléaire à 50 % de la production électrique est compatible avec une disposition comme celle qui consiste à déployer 7 millions de bornes de rechargement pour des véhicules électriques, et ainsi à favoriser l’accroissement de la consommation électrique. Dit autrement, il apparaît difficile d’avoir le beurre, l’argent du beurre et la crémière, et donc d’interpréter avec sérieux cette promesse de réduire la part du nucléaire dans le mix électrique.
Pourquoi ne pas avoir fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre l’objectif prioritaire et structurant du projet de loi de transition énergétique ?
Autre léger souci: si le Sénat avait certes supprimé l’objectif chiffré de réduction du nucléaire, il avait d'autre part fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre l’objectif principal de la loi, ce qui pour un projet devant en fait guider une transition entre un monde sous perfusion d’énergies fossiles bon marché et un monde énergétiquement et climatiquement contraint, ne semble pas forcément absurde aux yeux des experts. Fallait-il jeter le bébé avec l’eau du bain et, à quelques encablures de la conférence des Nations-Unies sur le climat de Paris en décembre, supprimer la priorité donnée au climat dans cette loi?
« Les combustibles fossiles constituent les 3/4 de notre consommation d’énergie et 100 % de nos émissions de CO2, et grèvent notre balance commerciale. Dans le domaine de la sortie des énergies fossiles, les engagements pris dans le projet de loi sont pour l’instant faibles, loin, très loin de l’urgence de l’enjeu. Les députés de la commission spéciale ont fait le choix explicite « de retenir (…) un ensemble d’objectifs sans hiérarchie particulière ». Dans un contexte économique contraint, revendiquer une telle absence de hiérarchie (autrement dit prétendre que l’on peut tout faire à la fois) est un vœu pieu qui risque d’aboutir à une impasse », prévient le think tank de la transition carbone The Shift Project qui avait appelé les députés « à faire de la réduction des émissions de gaz à effet de serre l’objectif prioritaire et structurant du projet de loi de transition énergétique ».