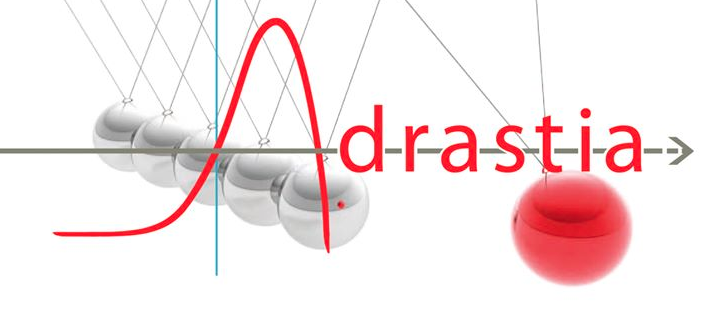L'utilisation du pétrole, du charbon et du méthane (gaz dit « naturel ») est la première cause du réchauffement global. En brûlant les énergies fossiles, on transfère en fait du carbone stocké jusqu’alors dans un cycle long, géologique, se mesurant en millions d'années, vers un cycle beaucoup plus court, se calculant plutôt en dizaines sinon en centaines d'années. Allant vers la surchauffe, ce cycle est celui de la vie, celle des végétaux, des animaux, de nous-mêmes.
A l’état de CO2, le carbone réside en moyenne dans l’atmosphère entre 50 et 200 ans selon les conditions du moment. L’Institut français du pétrole donne une moyenne de 125 ans. Pour nous, c’est long, mais à l’échelle des temps géologiques, c’est très court. Par exemple, il faut environ 200 millions d’années pour passer du stade de carbone-vivant au stade de carbone-pétrole par la fossilisation. Si bien qu’on peut schématiquement distinguer, à l’instar de feu Pierre-André Bourque, professeur émérite de géologie de l’Université Laval de Québec, un cycle court du carbone (au niveau de l’atmosphère, de la surface terrestre, des êtres vivants), et un cycle long du carbone (fonds des océans, roches sédimentaires, mouvements tectoniques…).
Or, que fait-on avec l’extraction et l’utilisation en masse des combustibles fossiles (pétrole, charbon, méthane…) et avec aussi l’extraction du calcaire et la fabrication du ciment ? On force le bilan carbone global du système Terre. On accroît progressivement le stock de carbone atmosphérique, donc l’effet de serre, donc la température moyenne à la surface du globe.
Plus la température à la surface de la Terre grimpe, moins les océans et les écosystèmes terrestres auront de capacité d’absorption de CO2
Dit autrement, on enlève depuis deux siècles une partie du carbone jusqu’alors stocké dans un cycle long, celui de la fossilisation, de la géologie, pour le réinjecter dans un cycle beaucoup plus rapide, celui des êtres vivants. On réveille du carbone qui dormait. Dès 1995, le GIEC estimait cette quantité de carbone pur à six milliards de tonnes par an. On est maintenant à plus de 9 milliards de tonnes...
A ce jour, malgré les recherches –relayés par le GIEC- pour stocker du CO2 dans les entrailles de la Terre ou vers les abysses océaniques, on n’a pas trouvé le moyen de transférer au même rythme du carbone du cycle court vers le cycle long. L’absorption d’une partie de ce surplus (environ 1/4) se fait pour l’instant dans l’océan par les courants marins et le phytoplancton, et sur terre par le sol et les végétaux terrestres (pour environ un autre quart).
Du reste, ce « trop-plein » peut « doper » la photosynthèse, donc certaines plantes. Mais avec des limites et des risques de surchauffe : d’abord, les végétaux ne peuvent bien sûr pas se développer indéfiniment, et ensuite, la plante terrestre mourra un jour. Donc, elle redonnera au moins en partie à l’atmosphère, par fermentation, le CO2 qu’elle a capté pendant sa vie.
En plus, plus la température à la surface de la Terre grimpe, moins les océans et les écosystèmes terrestres auront de capacité d’absorption de CO2. Et plus le carbone issu des énergies fossiles que l'on brûle restera dans l'atmosphère, accélérant encore le phénomène de réchauffement global. C'est ce type d'accélération qu'il s'agit d'éviter en limitant le réchauffement global à +2°C.